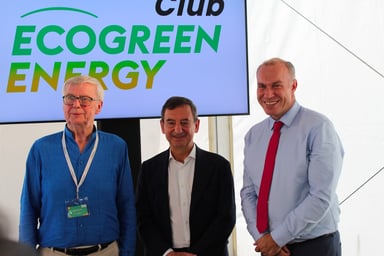Crise du Covid-19 et chute du pétrole : quelles seront les conséquences ?
La suite de votre contenu après cette annonce

C’est une première dans l’histoire de l’or noir : ce lundi, le cours du pétrole WTI[1] (la référence aux USA) a été négatif, plongeant jusqu’à -37 dollars le baril. Une chute vertigineuse de plus de 300 %, alors qu’il s’échangeait à plus de 14 $ US en début de journée. Au Canada aussi, le WCS[2] était dans le rouge dimanche soir. Comment expliquer cet effondrement et quelles pourraient être les conséquences à terme ?
Un prix négatif signifie concrètement que les investisseurs sont prêts à payer les acheteurs pour pouvoir leur fournir du pétrole. Précisons d’abord que ce prix concernait les livraisons prévues en mai aux USA et au Canada. Le baril de Brent, c’est-à-dire le pétrole de la mer du Nord coté à Londres, a mieux résisté, même s’il a tout de même perdu 6 % en un jour, terminant ce lundi soir à 20 dollars. Quant au WTI pour livraison en juin, il était aussi moins touché, cédant quand même près de 16 % à environ 21 $ le baril.
Pour comprendre cette situation, il faut savoir que le WTI est un contrat physique : si vous êtes propriétaire de brut à la date d’expiration, vous devez en prendre livraison. Or les contrats pour fourniture en mai se clôturaient ce mardi … et de nombreux investisseurs n’ont pas trouvé d’acheteurs du fait de l’effondrement de la demande, frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Selon les premières estimations, la consommation de pétrole dans le monde a chuté de 20 millions de barils par jour (mb/j) depuis le début de la crise ou même, d’après les analystes les plus pessimistes, de 30 mb/j. Dont près de 5 millions de barils pour les seuls États-Unis. Avant la pandémie, la production mondiale tournait autour des 100 mb/j.
En temps normal le brut qui ne trouve pas preneur est stocké. Mais aux Etats-Unis les capacités de stockage débordent, la guerre des prix que se sont lancés l’Arabie et la Russie début mars ayant inondé le marché de pétrole à bas prix.
Conséquence de tout cela : le marché regorge d’or noir et ne sait plus quoi en faire. N’importe quel oléoduc ou pétrolier est utilisé comme stockage. Les prix de location des navires ont d’ailleurs flambé. Et les infrastructures sont tellement saturées que certains producteurs sont prêts à payer pour être débarrassé de leurs barils.
Après des semaines de discussion, les pays producteurs, membres du cartel constitué par l’OPEP et la Russie, ont finalement conclu mi-avril un accord « historique » visant à réduire leur production de près de 10 millions de barils par jour, soit un dixième de l’approvisionnement mondial.
Bien qu’il s’agisse de la plus importante réduction de production jamais mise en œuvre par le cartel et ses partenaires, de nombreux observateurs s’accordent pour estimer qu’elle ne sera pas suffisante pour compenser l’écroulement de la consommation engendrée par la crise sanitaire.
Cet épisode de prix négatifs sera sans doute temporaire, mais comme nous nous en rendons compte chaque jour de plus en plus, la crise sanitaire est loin d’être terminée. On peut même raisonnablement s’attendre à ce que la relance de l’économie mondiale se fasse encore attendre pendant de nombreux mois, si pas plus d’un an. En conclusion, la période de déprime pour les producteurs de pétrole n’est pas près de se terminer.
Des pans entiers de l’industrie du pétrole sont à genoux
Les défenseurs de la planète, de l’environnement et des « automobiles propres » rêvaient depuis longtemps d’un monde dans lequel le pétrole ne vaudrait plus rien parce que plus personne n’en voudrait. Mais alors que leur combat, les quotas d’émissions et les réglementations imposant des réductions de consommation n’avaient jusqu’ici pas réussi à infléchir l’augmentation régulière de la production mondiale d’hydrocarbures, le coronavirus est parvenu, en quelques semaines, à mettre à genoux des pans entiers de l’industrie pétrolière.
Car, pour de nombreux acteurs, cette situation, même si elle est temporaire, est synonyme de catastrophe financière, en particulier pour les producteurs de pétrole de schiste aux Etats-Unis. Ce secteur, comme d’ailleurs celui des sables bitumineux au Canada, est en effet caractérisé par des coûts de production élevés. Si les prix de vente restent durablement inférieurs à leurs coûts, ces industriels, déjà lourdement endettés pour la plupart, risquent tout simplement la banqueroute. Une trentaine d’entre eux ont d’ailleurs déjà mis la clé sous le paillasson au cours des derniers mois. Ce 1er avril, Whiting Petroleum Corp, l’un des plus grands producteurs de pétrole de schiste dans le bassin du Dakota du Nord a fait aveu de faillite. Aux USA, le nombre de puits de forage a chuté de 66 unités la semaine dernière, la plus forte baisse hebdomadaire depuis 2015.
Autre conséquence classique dans les périodes de prix déprimés : les compagnies, y compris les plus grandes, réduisent leurs coûts d’exploration, ce qui entraîne des conséquences en cascade dans les entreprises de service pétrolier. Ainsi, Halliburton, géant américain du secteur, a enregistré une perte nette de 1 milliard de dollars au premier trimestre. Prévoyant des perspectives sombres au moins jusqu’à la fin de l’année, son patron annonce une réduction drastique des dépenses.
Parmi les autres répercutions de cette crise auxquelles on peut s’attendre, il est probable que les institutions bancaires hésitent de plus en plus à financer un secteur caractérisé de manière récurrente par des prix volatils, une situation économique instable et où de nombreux petits acteurs se trouvent au bord du gouffre.
Aux Etats-Unis, comme au Canada, les dirigeants, Donald Trump et Justin Trudeau en tête, ont déjà annoncé leur volonté de soutenir leur secteur pétrolier en péril. Le premier ministre canadien a notamment promis une aide de 1,7 milliards pour les exploitants de sables bitumineux dans l’Alberta. Faut-il le féliciter ?
[1] WTI : West Texas Intermediate
[2] WCS : Western Canadian Select
Avis de l'auteur
Bernard DEBOYSER
La suite de votre contenu après cette annonce
sur l'actualité électrique
Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !
Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres
S'inscrire gratuitement