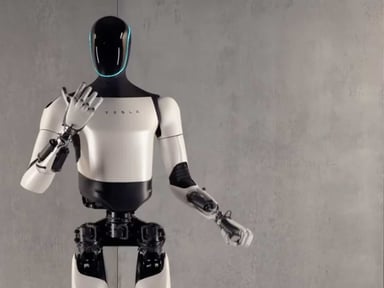Que se passerait-il si l’interdiction des voitures thermiques était repoussée à 2050 ?
La suite de votre contenu après cette annonce

Une partie des constructeurs automobiles européens demandent que l’interdiction des voitures thermiques prévue en 2035 soit repoussée à 2050. Mais cette demande ne fait pas l’unanimité dans le secteur. Essayons d’y voir un peu plus clair.
La décision européenne de mettre fin à la vente des voitures thermiques et hybrides en 2035 a été présentée comme un tournant décisif dans la quête d’un air plus pur au-dessus du Vieux Continent (et peut-être dans le reste du monde, mais c’est moins sûr).
Au départ, on trouvait ça plutôt bien. En tout cas positif, un « signal fort » comme disent les professionnels de la politique. Quand on roule en voiture électrique depuis déjà quelques années et que l’on est convaincu que c’est une énergie d’avenir pour les déplacements individuels, le fait qu’une instance de gouvernance fédérant plusieurs états arrive à mettre tout le monde d’accord sur une décision aussi radicale semblait plutôt bienvenu. Puis vient le temps des débats, et celui de la discorde. Et on finit par douter… Au final, l’Union européenne n’y serait-elle pas allée un peu trop fort, ou trop vite, avec cette fameuse interdiction de la vente de voitures thermiques neuves à partir de 2035 ?
Car depuis quelques mois, une fronde se dessine. Certains constructeurs appellent à repousser l’échéance à 2050, invoquant la difficulté d’adaptation de leur industrie, alors qu’ils ont disposé quand même de près de 15 ans pour la transformer. En face, une coalition inattendue et quelque peu disparate de plus de 150 acteurs de l’électromobilité, qui exhorte au contraire Bruxelles à tenir bon, dans une lettre ouverte adressée la semaine dernière à la Présidente de la Commission Européenne. Selon eux, un recul serait un pas en arrière industriel et stratégique. On notera au passage que, parmi les signataires de cette lettre, il n’y a pas que des sous-traitants, des équipementiers ou des pure players de la recharge ayant fortement investi dans l’électrification, mais aussi des constructeurs automobiles. Il s’agit précisément de Lucid, Volvo et Polestar. Oui, ils ne sont que trois, dont deux Chinois et un Américain…
Si l’on regarde la liste des signataires plus en détail, on y retrouve quasiment l’intégralité des grands noms de la recharge, opérateurs ou fabricants, que nous connaissons bien, à savoir – entre autres – Alpitronic, Allego, Bump, Powerdot, Driveco, Atlante, Fastned, Ionity, Izivia ou encore Electra. D’ailleurs, pour être tout à fait transparents, il y a également Chargemap, notre société sœur, appartenant au même groupe qu’Automobile Propre.
Plus étonnant, on trouve aussi dans ce manifeste les signatures de Uber et… AstraZeneca.
Mais que dit précisément cette lettre ouverte dont on parle beaucoup ?
En substance, les plus de 150 dirigeants de la filière européenne de la mobilité électrique signataires demandent à la Commission Européenne de ne pas reculer sur l’interdiction de la vente des voitures thermiques et hybrides neuves prévue en 2035. Pour eux, cet objectif, acté en 2023, a déjà produit des effets concrets sur l’industrie automobile européenne. Les signataires rappellent qu’il a déclenché des centaines de milliards d’euros d’investissements et permis la création de plus de 150 000 emplois sur le continent. Des investissements qui se sont notamment concrétisés par d’importantes levées de fonds. Pas sûr, par exemple, qu’un Electra aurait pu devenir quasiment une licorne en moins de 5 ans si les investisseurs n’avaient pas été « incentivés » par la perspective obligatoire du tout électrique dans 10 ans.
Ils estiment en outre qu’une reculade minerait la confiance des investisseurs et affaiblirait la compétitivité européenne face à des acteurs déjà très avancés comme la Chine, où la transition vers l’électrique progresse rapidement, et demandent à Bruxelles de renforcer son soutien par un développement massif de la production de batteries sur le sol européen, la sécurisation des matières premières stratégiques, des incitations harmonisées dans tous les États membres pour accélérer l’adoption des voitures électriques, et enfin, un investissement accru dans les réseaux électriques, spécifiquement via des réformes pour faciliter leur modernisation et leur raccordement.
Comme quoi, tout n’est pas aussi simple.
Mais quelles seraient les conséquences réelles — positives et négatives — d’un éventuel recul de l’échéance de 2035 pour les différents acteurs du secteur. Nous ne lisons pas l’avenir dans une boule de cristal, mais tâchons d’y voir un peu plus clair dans ce sujet qui semble se complexifier au fil des mois et des déclarations des différents acteurs.
Les constructeurs face au calendrier
Du côté des constructeurs, il paraît clair que repousser l’échéance à 2050 offrirait un répit confortable. Prolonger la vie des motorisations thermiques permettrait de lisser les investissements, de rentabiliser les modèles existants et de mieux gérer une demande électrique encore fragile sur certains segments. BMW, pourtant engagé avec succès dans l’électrification de sa gamme, souligne que le marché de l’électrique n’a pas encore atteint son rythme de croisière, ce qui fragilise les marges. Mercedes, de son côté, redoute qu’une transition trop brutale fasse plus de mal que de bien à son écosystème industriel.
Un point du vue qui semble malheureusement corroboré par ce rapport de la Cour des Comptes européenne (2024 – article payant), émettant de sérieux doutes sur la faisabilité du passage au tout électrique en 2035 : « La disparition des voitures thermiques suppose en effet, en contrepartie, une adoption massive des véhicules électriques par le grand public. Or, celle-ci apparaît compromise compte tenu du prix à payer par l’industrie et le consommateur ».
Mais derrière cette apparente sécurité se cache un risque majeur, qui est celui de briser l’élan déjà engagé. Les constructeurs européens ont investi des centaines de milliards d’euros pour développer des gammes électriques compétitives, et créé plus de 150 000 emplois dans cette filière. Revenir sur la date de 2035 reviendrait à diluer ces efforts et à affaiblir la confiance des investisseurs. Pire, cela donnerait aux concurrents chinois – qui avancent à marche forcée sur l’électrique – l’occasion de creuser l’écart, même s’il existe un point de vue radicalement différent sur le sujet. D’autre part, en dehors des considérations purement économiques, on sait que, généralement, la contrainte stimule l’innovation, un précepte qui est certainement applicable et favorable au contexte de la voiture électrique.
Des fournisseurs entre deux feux et les infrastructures en suspens
Les sous-traitants historiques – ceux qui produisent moteurs thermiques, boîtes de vitesses ou échappements – verraient dans un report une bouffée d’air qui leur donnerait plus de temps pour se transformer, plus de contrats pour leurs pièces, et moins de pression pour basculer vers l’électrique.
Pour la filière batterie, en revanche, un tel glissement ne serait pas vraiment une bonne nouvelle. Des projets de gigafactories en France, en Allemagne ou en Slovaquie pourraient perdre en attractivité si le marché européen ralentissait, alors que le contexte est déjà difficile. Les investissements risqueraient alors de se déplacer vers les États-Unis ou l’Asie, où les perspectives restent claires et soutenues par des politiques incitatives. Et l’Europe, qui cherche justement à bâtir une chaîne d’approvisionnement souveraine pour les matériaux critiques, se retrouverait fragilisée.
Un délai de quinze ans supplémentaires permettrait aux opérateurs d’électricité et aux installateurs de bornes de recharge de mieux étaler leurs investissements. Moins de pression, moins de risques de saturation, plus de temps pour moderniser les réseaux. Sur le papier, la transition serait moins brutale. Mais là encore, l’élan pourrait s’essouffler. Les réseaux intelligents, la recharge bidirectionnelle ou les stations ultra-rapides n’avancent que si le marché des voitures électriques progresse vite. Sans la contrainte de 2035, les déploiements pourraient ralentir, laissant l’Europe dépendre plus longtemps des stations-service classiques. Pendant ce temps, les géants asiatiques de la recharge et du smart grid continueraient de gagner du terrain. C’est un peu l’histoire de l’œuf et de la poule : il faut plus de voitures électriques pour accélérer le déploiement des points de charge, mais il faut plus de points de charge pour développer les ventes de VE…
Et l’emploi dans tout ça ?
Sur le plan social, repousser la date de 2035 prolongerait l’existence de millions d’emplois liés au thermique. Les usines de moteurs, les ateliers de maintenance et les réseaux de concessionnaires continueraient de tourner sans heurts. Les formations auraient davantage de temps pour évoluer en douceur. Mais ce statu quo bloque aussi la création d’emplois nouveaux. Les 150 000 postes déjà générés par l’électromobilité pourraient ne pas être suivis de la vague attendue. Les talents spécialisés dans la batterie ou l’électronique de puissance risqueraient de migrer ailleurs, là où la demande est réelle, soit sur d’autres continents, soit dans d’autres secteurs d’activité. Cependant, le passage au tout électrique nécessiterait certainement des ajustements et des mesures de soutien à l’emploi dans régions et pour les emplois concernés. D’autre part, il subsiste un risque d’inégalités territoriales dans certaines zones ou l’infrastructure électrique est peu développée ou d’un accès plus difficile, et même d’inégalités entre états membres de l’UE.
Environnement et souveraineté en victimes collatérales ?
Enfin, repousser l’échéance reviendrait à maintenir en circulation des millions de voitures polluantes supplémentaires. Les objectifs de neutralité carbone de l’Union européenne seraient d’autant plus difficiles à atteindre. Le Green Deal perdrait en crédibilité, et avec lui la capacité de l’Europe à s’affirmer comme un leader dans la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui semble devenu une sorte de mantra obsessionnel chez certains représentants de l’UE.
Il y a aussi un enjeu de souveraineté industrielle. Aujourd’hui, la Chine domine largement la production de batteries et contrôle une grande partie des matières premières. En ralentissant, l’Europe risquerait d’accentuer cette dépendance au lieu de consolider ses propres filières. Comme le souligne la lettre ouverte adressée à Ursula von der Leyen, hésiter maintenant serait « remettre les clés de l’avenir automobile entre les mains des concurrents ».
Cela étant, il existe un autre scénario possible, un choix de l’entre-deux, qui consisterait non pas à repousser l’échéance de 2035 mais à en assouplir les règles. C’est peut-être vers celui-ci que se dirige la Commission sous la pression des constructeurs. Dans cette hypothèse, on pourrait imaginer un élargissement aux hybrides ainsi qu’aux carburants de synthèse, voire même à l’hydrogène dans certains cas spécifiques. Rappelons à ce sujet que le credo des constructeurs et de ne pas remettre en question le Pacte Vert, mais la méthode, autrement dit qu’on fixe un objectif, mais qu’on ne leur impose pas la façon de l’atteindre.
Quoiqu’il en soit, notre mauvais esprit ne peut s’empêcher de voir dans ce bras de fer une sorte de guérilla des lobbies, qui semble bien loin de l’idéal écologique auquel aspire la Commission Européenne. D’un côté les constructeurs qui veulent préserver un peu plus longtemps leur rente thermique, de l’autre les équipementiers qui veulent accélérer l’électrification pour faire grossir leur business… et rentabiliser rapidement leurs énormes investissements.
Entre les deux, les consommateurs, auxquels finalement personne n’a vraiment demandé leur avis.
PS : vous pouvez télécharger la lettre ouverte ici (PDF)
sur l'actualité électrique
Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !
Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres
S'inscrire gratuitement