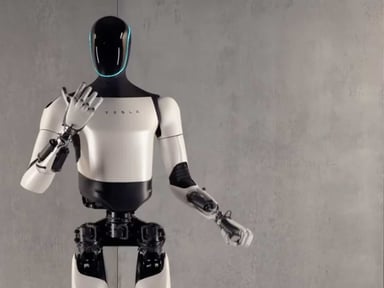Voiture électrique : la recharge à destination est-elle réellement adaptée aux usages des électromobilistes ?
La suite de votre contenu après cette annonce

Le déploiement de points de recharge sur les lieux de séjour, de restauration ou de shopping pose la question de l’adaptation de la puissance aux besoins. Une équation à plusieurs paramètres qui n’est pas aussi simple qu’il n’y parait.
Maintenant que toutes les aires de service autoroutières sont richement équipées en stations de recharge haut débit, et que la France compte parmi les meilleurs élèves européens de la spécialité, le sujet de la densification et du maillage du réseau de recharge sur d’autres points stratégiques passe au premier plan.
C’est ce qu’on appelle généralement la recharge à destination, qui elle-même autorise la recharge en temps masqué, à savoir l’usage qui consiste à profiter d’une activité pour remettre un peu de jus dans sa batterie. C’est typiquement ce que les électromobilistes font pendant une nuit à l’hôtel ou une session de shopping dans un centre commercial ou une grande surface.
Adapter l’offre de puissance à l’usage réel avec la data et le smart charging
Se pose alors la question de l’adaptation de l’offre de puissance à l’usage réel. Et il semblerait que dans ce domaine il y ait encore quelques ajustements à faire. On voit, par exemple, des parkings d’hôtels et de centres commerciaux équipés de bornes DC très puissantes, 100, 150 kW et parfois plus. Sur le papier, c’est rassurant, car cela montre que l’établissement « est prêt ». Mais est-il vraiment nécessaire de proposer de telles puissances quand on sait justement que la plupart des arrêts à destination — nuitée, repas, shopping — durent plusieurs heures ou, au pire, une à deux heures. Dans ces créneaux, une borne AC de 11 à 22 kW couvre la plupart des besoins et remet facilement plusieurs dizaines à quelques centaines de kilomètres d’autonomie, selon le véhicule. Il me semble alors qu’installer systématiquement du 150 kW dans ce contexte, c’est souvent installer de la puissance qui ne sera presque jamais sollicitée.
Pourquoi ce décalage ? Il s’explique probablement par un mix (ou une confusion) entre image commerciale et intérêts économiques. Afficher des chargeurs ultra-rapides renvoie une image plus flatteuse et peut attirer une clientèle sensible à la technicité. Pour certains intégrateurs et fournisseurs, proposer du matériel haut de gamme représente aussi une marge plus importante. Enfin, trop de projets se montent sans diagnostic local précis : pas ou peu de données sur la durée moyenne des arrêts, sur le type de véhicules ou sur les flux réels. Quand il manque ces informations, le choix facile devient celui de la surcapacité.
Les conséquences d’une mauvaise adaptation ne sont pas neutres en termes de coûts et de retour sur investissement. Les postes de transformation, les raccordements haute puissance et les bornes DC pèsent lourd en investissements. Des coûts qui rallongent le délai de retour sur investissement et peuvent laisser des infrastructures sous-utilisées pendant longtemps. Sur le plan du réseau électrique, multiplier des raccordements puissants sur des zones non prévues pour cela conduit parfois à des pics de consommation locaux, des renforcements coûteux et des factures plus élevées. Au final, une part importante de la puissance installée peut rester en grande partie inutilisée. Un autre effet négatif est celui de l’allocation des ressources. L’argent investi dans des bornes surdimensionnées n’est pas disponible pour densifier un maillage utile, moderniser la gestion de la charge ou financer des solutions de stockage qui permettraient de mieux lisser la demande.
Alors, quelle serait la stratégie idéale de déploiement des points de charge ? Peut-être intégrer dans les calculs un mix de données au-delà de la géographie et la fréquentation. Comme prendre par exemple en compte la durée moyenne de stationnement (entre 30 minutes chez McDo, 1 heure chez Ikea, 2 heures au restaurant, et 12 heures chez Ibis le besoin n’est pas le même), ajoutée à la puissance moyenne de recharge du parc électrique en fonction de celle qui est proposée (toutes les voitures ne sont pas équipées pour charger de façon optimale en 22 kW).
Des demandes différentes, y compris sur un même point de charge
C’est simple, n’est-ce pas ? Eh bien pas tant que cela. Car ces fichus clients font tout pour ne pas rentrer exactement dans les bonnes cases. Il arrive, par exemple, parfois qu’un électromobiliste fasse un stop à l’hôtel, non pas pour y passer la nuit, mais juste pour déjeuner ou dîner. Il sera alors ravi de trouver une borne haut débit qui lui permettra de récupérer un maximum d’énergie durant ce laps de temps. Dans ce cas, la borne 11 kW ne sera pas suffisante. Mais il y a aussi le cas de celui dont la voiture va être rechargée à bloc en moins de 2 heures sur une borne DC de 150 kW. C’est parfait car cela permet une meilleure rotation, et donc à plusieurs clients de recharger successivement sur la même borne. Sauf que, dans la réalité, qui va se lever à 1 heure du matin pour aller déplacer sa voiture ? Peut-être alors que la bonne solution sera l’intermédiaire, à savoir une borne 50 kW en double standard AC et DC. Une autre solution serait celle qui s’adapte d’elle-même à la demande et à la puissance disponible, avec des batteries tampons capables de lisser les pointes, ou un dispositif de smart charging qui répartit la puissance disponible entre plusieurs véhicules selon leur profil et leur temps d’arrêt.
Enfin, il y a aussi le cas des hôtels ayant conclu un partenariat avec un CPO (Charging Point Operator), ce qui a souvent pour conséquence de proposer des bornes à haut débit, comme celle d’Electra au Novotel de Bron, en région lyonnaise, avec des bornes Alpitronic pouvant délivrer jusqu’à… 1000 kW permettant de charger jusqu’à 8 véhicules simultanément en puissance partagée.
Vous savez pourquoi le sujet est plus complexe qu’il n’y parait ? La première raison est humaine : les électromobilistes ne sont déjà pas d’accord entre eux sur les stratégies et les offres à proposer. Quand on aborde le sujet, un débat s’installe généralement très vite, avec autant de points de vue que d’intervenants (il se pourrait d’ailleurs que cela se reproduise sous cet article). Il y a donc probablement une part d’irrationnel dans cette question, ce qui rend son appréhension d’autant moins aisée. Et surtout d’importantes diversités d’usages, y compris sur un même point de charge.
D’ailleurs, même sur autoroute, royaume du haut débit, tout n’est pas aussi évident, puisqu’il subsiste des bornes 50 kW auprès desquelles nombre d’électromobilistes trouvent leur bonheur, puisqu’elles leur permettent de récupérer de quoi parcourir 150 à 200 km en moins d’une heure, le tout à un tarif souvent un peu plus avantageux.
sur l'actualité électrique
Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !
Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres
S'inscrire gratuitement