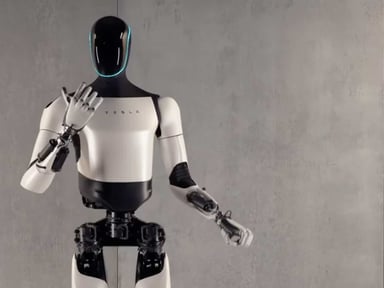Voitures électriques d'occasion : cet indicateur qui change tout (et qui va devenir obligatoire)
La suite de votre contenu après cette annonce

L’Europe prépare un nouveau règlement qui devrait sécuriser et dynamiser le marché de la voiture électrique d’occasion.
L’état de santé de la batterie d’une voiture électrique est un critère déterminant pour le marché de la seconde main. Il est possible de le connaître précisément, mais cela peut s’avérer long et coûteux. Un règlement européen va changer cela.
Quand on achetait une voiture thermique d’occasion, on regardait principalement le kilométrage, le carnet d’entretien, l’état général de la voiture… et on priait très fort au moment de faire le chèque. C’était un peu le règne de l’empirique et du doigt mouillé. Mais ça, c’était avant.
Avec l’électrique, les règles changent. On sait que, généralement, une voiture électrique est plus fiable, plus « simple » dans sa conception, avec beaucoup moins de pièces en mouvement, des sources potentielles de pannes plus réduites, et aussi moins d’entretien. Mais il reste un gros morceau, qui demeure une sorte de boîte noire, ou d’énigme pour de nombreux acheteurs, celui de la batterie, et de son état d’usure. Que l’on appelle d’ailleurs plutôt état de santé ou, dans le jargon des initiés, SoH (pour State of Health).
C’est probablement même la raison principale qui fait que certains hésitent encore à franchir le pas. Et on peut les comprendre. Entre l’anxiété de l’autonomie et les fake news qui continuent à être abondamment distillées sur le sujet, comment ne pas être inquiet à l’idée de mettre une somme conséquente dans une occasion électrique si l’on doute de sa capacité à faire de longs trajets, et si l’on pense que sa batterie, réputée hors de prix, risque de devoir rapidement être remplacée ?
Heureusement, il existe des moyens déjà éprouvés de mettre à l’épreuve cette donnée vitale qu’est l’état de santé de la batterie, à savoir son état général, et surtout la capacité restante au moment de l’achat. Rappelons au passage que l’on considère qu’une batterie de voiture électrique doit être remplacée lorsqu’elle atteint 70% de sa capacité initiale, un seuil rendant la voiture quasiment inutilisable. Mais alors, que deviennent ces batteries ? Elles connaissent une nouvelle vie en étant utilisées comme sources d’énergie stationnaire. Puis, quand elles sont réellement hors service, elles partent dans une filière de recyclage. On sait cependant que près de 80 % des voitures conservent plus de 90 % de leur capacité utile d’origine après 150 000 km.
Bref, tout cela pour dire que la batterie se transforme doucement mais sûrement en actif stratégique. Pendant des années, le débat “combien ça tient une batterie ?” a animé les forums, les concessions et les conversations de parking. Désormais, la question s’oriente davantage vers : comment certifier et valoriser l’état réel d’un pack en vue d’une revente ?
Car une voiture électrique d’occasion avec une batterie en bon état se revend plus vite, plus cher et avec moins de stress pour l’acheteur comme pour le vendeur. Le SoH s’invite au centre d’un écosystème avec un indicateur chiffré et opposable. Pour un particulier qui achète, c’est la garantie de ne pas tomber sur une “belle affaire” qui masque un vieillissement accéléré. Pour un professionnel, c’est une donnée qui conditionne la valeur résiduelle, les barèmes de reprise, voire les durées d’amortissement.
Pourquoi la santé de la batterie devient un actif qui pèse lourd
Pour comprendre pourquoi le SoH prend autant d’importance, il suffit de regarder ce qui se passe déjà sur le terrain. Aujourd’hui, trois grandes familles de tests cohabitent, avec des niveaux de précision et de traçabilité très différents.
La lecture OBD, la plus répandue (ou en tout cas la plus connue) reste la méthode la plus accessible. Il suffit d’un adaptateur, d’une application, de quelques secondes d’analyse, et on obtient un chiffre qui semble fiable et crédible. Ça, c’est pour la théorie. Dans la réalité, le problème est que ce chiffre dépend énormément des constructeurs, des versions logicielles, et parfois même des conditions de charge. Pour faire simple, c’est le constructeur qui fournit des données qu’il a lui-même programmées, en fonction de critères algorithmiques qui lui sont propres. Résultat, une qualité très variable, difficile à opposer dans un contexte de litige. C’est ainsi que vous pouvez voir, sur des sites d’annonces, des voitures électriques déjà assez fortement kilométrées affichant étrangement un SoH de… 100 %. Dans l’affaire, tout le monde est de bonne foi, c’est juste le mode de calcul du SoH par le constructeur qui est, disons, « avantageux ».
Il y a ensuite le test dynamique, souvent réalisé en concession, qui repose sur l’analyse des courants et tensions en conditions stabilisées. Là, on est déjà un cran au-dessus, avec davantage de cohérence et de traçabilité. De nombreux concessionnaires (Hyundai, Renault, Kia…) proposent désormais ce type de mesure pour délivrer un certificat de santé de batterie. Ce certificat devient alors un vrai sésame lors d’une revente.
Enfin, il reste la méthode réputée la plus fiable, celle de la décharge contrôlée, qui est un peu l’équivalent d’un test d’effort à l’hôpital. On vide réellement la batterie dans un environnement contrôlé, on mesure l’énergie restituée, on compare avec la capacité nominale. Le résultat est incontestable d’un point de vue métrologique. C’est la référence ultime en cas de litige, mais la méthode est longue et coûteuse, donc rarement réalisable à grande échelle.
Le Passeport Batterie va changer la donne
Ces trois approches coexistent encore, mais l’avenir va les inciter à converger. Le marché n’acceptera pas éternellement des mesures hétérogènes. Une norme de fiabilité va émerger, d’autant que le règlement européen sur les batteries va changer la donne. À partir du 18 février 2027, chaque véhicule électrique vendu en Europe devra disposer d’un passeport batterie. Ce document numérique, associé à un QR code unique, contiendra l’historique complet du pack : capacité réelle, interventions éventuelles, données de performance, conditions d’usage, cycles de charge, émissions liées à la fabrication… et bien sûr, le SoH certifié.
Conséquence, le SoH ne sera plus un chiffre sorti d’une application. Ce sera une donnée normée, associée à un passeport batterie certifié, stocké dans un registre électronique, consultable par n’importe quel acheteur et impossible à maquiller. L’ère des “batteries mystère” arrive donc à sa fin puisqu’un seul chiffre certifié fera foi. Et ce n’est pas un détail, car c’est le futur levier qui déterminera la valeur d’un véhicule électrique d’occasion. Ce qui aura probablement d’autres répercussions sur le marché. D’une part, sur les financements et les assurances, car on peut aisément imaginer que les loueurs longue durée, les banques et les assureurs seront tentés d’indexer leurs tarifs et leurs garanties sur la santé mesurée et certifiée de la batterie. Pas sûr qu’ils le fassent, mais ils en auront en tout cas la possibilité technique. D’autre part, les constructeurs eux-mêmes vont devoir entrer dans une logique de transparence. Une marque qui garantit la longévité de ses batteries, qui propose des tests certifiés, qui documente des courbes de dégradation stables, verra ses valeurs résiduelles grimper et ses offres de financement devenir plus compétitives. Autre effet induit, il sera probablement plus difficile de trafiquer le kilométrage, car celui-ci pourra être vérifiable avec une certaine précision grâce au « CV » de la batterie, indiquant notamment le nombre de cycles de recharges.
Pour les acheteurs, c’est sans doute une petite révolution qui se prépare. Finie l’incertitude sur la santé et la capacité réelle de la batterie des voitures électriques d’occasion. Reste à savoir si cette transparence va dynamiser le marché de l’occasion, ou au contraire… le plomber. Un indice : une batterie lithium-ion peut encaisser de 1 000 à 2 000 cycles de recharge complets, selon son usage et sa technologie, et jusqu’à 5 000 cycles avec une bonne gestion de la recharge en respectant les bonnes pratiques de préservation de la batterie. Si l’on prend en compte une moyenne de 15 000 kilomètres parcourus par an avec une consommation de 18 kWh/100 km et une batterie de 50 kWh, cela donne 54 recharges à 100% par an (environ une par semaine, ce qui semble cohérent). En prenant la fourchette basse de 1 000 cycles, cela donne une longévité de batterie de 18 ans, et 36 ans pour 2 000 cycles, avant que la batterie n’atteigne le seuil minimal nécessitant son remplacement.
De quoi être rassuré, non ? Le Passeport Batterie viendra alors en renfort pour finir de sécuriser les futurs acheteurs.
sur l'actualité électrique
Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !
Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres
S'inscrire gratuitement