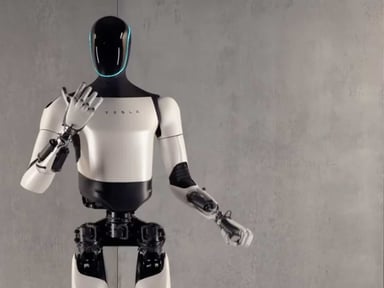Recharge de voiture électrique : l'Allemagne a un plan pour accélérer, et si on s'en inspirait ?
La suite de votre contenu après cette annonce

Les infrastructures de recharge de voitures électriques en Europe se sont fortement développées au cours de la dernière décennie. Mais on peut encore faire mieux.
L’Allemagne, qui généralement ne fait pas les choses à moitié quand elle s’empare d’une question industrielle, a récemment dévoilé son Masterplan 2030 pour les infrastructures de recharge. Un plan en cinq chapitres et trente-sept propositions de mesures ayant pour objectif de faciliter et accélérer le développement des infrastructures de recharge de véhicules électriques, particuliers et utilitaires, sur son territoire.
Le document, très dense (lien à la fin de cet article), montre qu’aucun aspect de la question n’a été négligé, et que certains angles morts — qui pourraient presque être considérés comme marginaux — ont même été pris en compte, ce qui témoigne d’une réflexion en profondeur et d’une vision très large du sujet.
Chez Automobile Propre, la question de la recharge nous tient évidemment à cœur, et nous ne sommes pas avares de contenus et préconisations autour du sujet, mais ce n’est pas une raison pour ne pas regarder ce qui se fait chez nos voisins, et d’en extraire quelques bonnes idées qui pourraient être applicables par ici.
Même si, en France, nous n’avons pas à nous plaindre de l’infrastructure de recharge, qui figure toujours sur le podium des plus développées et performantes en Europe, grâce notamment au dynamisme de nombreuses entreprises et start-up locales œuvrant dans différents domaines — software et hardware — on peut toujours faire mieux.
Voici cinq points inspirés du Masterplan allemand qu’il nous semblerait pertinent de développer dans le contexte de nos propres infrastructures de recharge.
Une campagne de communication sur l’électromobilité
C’est un sujet qui revient fréquemment parmi les électromobilistes et autres experts et analystes du secteur au regard des torrents de fake news qui continuent à donner une vision déformée, voire erronée de la voiture électrique. Des fausses informations qui, malheureusement, ne proviennent pas que des réseaux sociaux, mais également de grands médias, dont certains reportages ficelés à la va-vite par des journalistes peu au fait du sujet, ont certainement largement contribué à la défiance du grand public — ou d’un certain public.
Le problème, dans ce contexte, provient aussi du fait que, à notre connaissance, l’État, ou ses gouvernements, n’ont jamais vraiment pris leur part dans la communication autour du sujet, déléguant cela aux constructeurs, avec tous les biais, réels ou supposés, que cela peut impliquer, quand l’information devient marketing. Même quand on n’attend pas grand-chose de l’État, a fortiori quand il s’agit pour ce dernier de s’immiscer dans les affaires des entreprises privées, quand celui-ci impose des règles, nationales ou européennes, le fair-play voudrait qu’il accompagne le marché avec autre chose que seulement des règles, normes et contraintes. Dans ce contexte, une ambitieuse campagne de communication grand public sur les avantages de la voiture électrique serait, nous semble-t-il, la bienvenue.
La promotion de la recharge bidirectionnelle comme argument commercial
La recharge bidirectionnelle, ou Vehicle-to-Grid (V2G), est l’une des technologies les plus prometteuses, mais aussi les plus sous-côtées de l’électromobilité. Pouvoir stocker de l’énergie dans la batterie de sa voiture électrique, puis en redistribuer à discrétion le surplus inutilisé vers d’autres équipements électriques, constitue un avantage et un progrès remarquables, en transformant la voiture électrique en bien plus qu’un simple moyen de transport. Grâce à cette technologie, l’énergie circule dans les deux sens : non seulement la voiture se recharge, mais elle peut aussi réinjecter de l’électricité dans le réseau, alimenter une maison (Vehicle-to-Home, V2H) ou équilibrer la demande énergétique lors des pics de consommation. Chaque voiture devient ainsi une centrale électrique roulante.
Sur le plan économique, la généralisation de la recharge bidirectionnelle à toutes les bornes et stations serait également stratégique. Pour les particuliers, cela ouvrirait la voie à des revenus complémentaires, issus de la revente d’énergie stockée ou de la participation à des programmes de flexibilité. Pour les entreprises et opérateurs de recharge, c’est une source de valeur ajoutée inédite fondée sur l’optimisation du réseau, la fidélisation client, et de nouveaux services énergétiques.
Une offensive volontariste contre le vol de câbles
Même si le phénomène reste encore marginal, le vol de câbles sur les bornes pourrait constituer un argument de plus en faveur des « anti » pour freiner l’adoption de l’électromobilité. Ces dégradations diminuent la disponibilité du réseau, renchérissent les coûts d’exploitation et cassent la confiance des usagers qui peuvent tomber sur des points HS. D’où l’intérêt d’un plan de sécurisation à la fois technique et opérationnel. Côté matériel, les solutions existent déjà : câbles captifs avec verrouillage mécanique motorisé côté borne et côté connecteur, gaines anti-intrusion en acier tressé, visserie inviolable, têtes moulées « potting » rendant le cuivre inexploitable, enrouleurs ou bras aériens rétractables pour limiter l’accès hors session, capteurs d’arrachement/accéléromètres intégrés qui déclenchent alarme locale et notification cloud, ainsi que marquage chimique/UV ou « ADN » et numérotation sérialisée pour tracer le câble dans la filière de recyclage.
Il resterait à généraliser ces modes de prévention, en y ajoutant une cartographie des hotspots de vols, et pourquoi pas une franchise d’assurance réduite pour les opérateurs certifiés « site sécurisé ».
Un renforcement de la cybersécurité sur les points de charge
Les bornes de recharge pour voitures électriques sont devenues des cibles de choix pour les cybercriminels, car elles combinent trois vecteurs sensibles : la connectivité au réseau, les paiements numériques et l’accès direct aux véhicules. Chaque point de charge communique en continu avec des serveurs d’opérateurs et échange des données avec le véhicule, notamment sur l’identité, le statut de charge ou la facturation. Ces interactions créent des portes d’entrée potentielles : attaques par QR codes falsifiés menant à des sites frauduleux, compromission du firmware de la borne pour détourner des paiements, extraction de données personnelles via des failles d’API, voire injection de malwares dans le système embarqué de la voiture. Dans certains cas, des pirates ont même exploité des bornes pour perturber le réseau électrique local ou déstabiliser un opérateur via des attaques DDoS massives.
Pour sécuriser cet écosystème, un plan national de cybersécurité de la recharge pourrait être déployé. Il reposerait sur des exigences de certification pour tout matériel et logiciel de borne, un audit régulier des opérateurs par l’ANSSI, voire la mutualisation d’un centre de supervision cyber dédié aux infrastructures de mobilité électrique. Couplé à la sensibilisation des exploitants et des usagers, un tel plan garantirait la résilience numérique du réseau de recharge, devenant stratégique en temps que composante du système énergétique national.
Pas de frais de blocage pendant la nuit
Alors, j’avoue que celle-ci est assez inattendue. De quoi s’agit-il exactement ? Tout simplement du fait que nombre d’opérateurs de points de charge facturent un montant au temps passé quand une voiture est branchée sur une borne, soit en plus du prix de la recharge, soit en supplément une fois celle-ci terminée, si la voiture reste branchée sans charger, « squattant » alors l’emplacement. Généralement, c’est plutôt une bonne chose, sauf dans certains cas particuliers, notamment lorsque l’on recharge de nuit, et qu’on a branché sa voiture en arrivant par exemple à l’hôtel. Difficile alors de mettre une alerte de fin de charge et de se lever au milieu de la nuit pour aller débrancher et déplacer sa voiture. Ce qui ne changerait probablement pas grand chose, car à l’inverse, qui va se lever à 3 h 00 du matin pour aller mettre sa voiture en charge ? Dans ce cas particulier, le Masterplan allemand suggère qu’une réglementation soit adoptée interdisant les frais de blocage aux bornes de recharge normales pour les voitures particulières entre 22 h 00 et 8 h 00. Une mesure de bon sens qui ne changera certainement pas grand-chose dans la conversion vers l’électrique, mais qui envoie un signal positif aux voyageurs en évitant de les pénaliser inutilement.
Communication, technologie, aspects pratiques, tous les volets de la question de la recharge sont à prendre en compte pour accompagner le développement de l’électromobilité, qui ne se mesure pas seulement par le nombre de voitures électriques en circulation.
Source : le Masterplan allemand (Masterplan Ladeinfrastruktur 2030)
sur l'actualité électrique
Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !
Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres
S'inscrire gratuitement