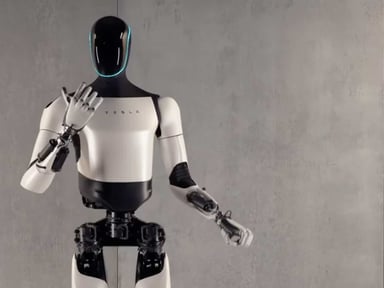Autonomie des voitures électriques : et si on arrêtait avec les petits mensonges du WLTP ?
La suite de votre contenu après cette annonce

Il serait peut-être temps de revoir la norme WLTP afin de fournir des mesures d’autonomie plus proches de la réalité.
Le débat ne cesse jamais, mais il reprend de la vitalité chaque année à l’approche de l’hiver : le cycle WLTP serait totalement fantaisiste quand il s’agit de mesurer la consommation d’énergie, et donc l’autonomie des voitures électriques. Ce que l’on reproche à cette norme ? D’être optimiste, voire trop optimiste dans les chiffres indiqués. Les plus radicaux prétendent même qu’il faut littéralement diviser par deux le chiffre fourni pour avoir une idée de l’autonomie réelle d’une électrique sur autoroute par temps froid.
Peut-on leur donner tort ? Pas vraiment, a fortiori si l’on considère que la « vraie » autonomie d’une électrique se mesure dans la plage utilisable couramment, qui est généralement située de 15% à 80% de capacité de la batterie. Ce qui conduit à ce résultat quelque peu faussé. Même si l’on considérait raisonnablement qu’il faille retirer environ « seulement » 20% à l’autonomie WLTP, si en plus l’on reste dans la plage d’utilisation courante de 15-80%, on ampute déjà cette dernière de plus de moitié au total. Bien sûr ce n’est pas toujours le cas, car il y a aussi ces fois où vous partez chargé à 100% de chez vous, que vous préchauffez la voiture avant de démarrer alors qu’elle est encore branchée (ce qui réduit sa consommation pendant les premiers kilomètres), et que vous arrivez à moins de 5% car vous savez que vous avez une solution de recharge à destination. Mais c’est un cas de figure qui ne peut être appliqué à ceux qui résident en habitat collectif et ne disposent pas encore de solution de recharge sur leur parking (soit quand même près de la moitié de la population française), ni d’une borne à l’arrivée.
Bref, le WLTP c’est pas le pied, même si l’on a bien compris que ce standard sert surtout à comparer les voitures entre elles.
Et c’est un problème, car ce décalage entre le chiffre officiel et la réalité du terrain fait des ravages. D’une part, il donne du grain à moudre à ceux qui détestent la voiture électrique et qui crient à l’arnaque. D’autre part, il angoisse ceux qui hésitent à franchir le pas. Pire, il installe une méfiance, voire une défiance, généralisée. Pourtant, les constructeurs ne mentent pas techniquement : ils appliquent une loi, une norme, un cycle, appelez cela comme vous voulez. Et c’est ce satané WLTP qui ne correspond pas à la vraie vie, comme souvent quand une norme est définie par des gens dans un bureau. Attention, le discours n’est pas de dire que ce standard est un truc de bureaucrate déconnecté, mais de voir pourquoi il n’est pas toujours (le « toujours » est important, nous le verrons plus loin) réaliste, et comment la mesure de l’autonomie des électriques pourrait être améliorée. Pourquoi un tel écart ? Pourquoi votre voiture semble-t-elle vous lâcher dès que vous prenez l’autoroute ? Et surtout, comment pourrait-on enfin afficher des chiffres honnêtes pour redonner confiance à tout le monde ?
Pourquoi votre voiture consomme beaucoup plus que prévu
Pour comprendre l’embrouille, il faut regarder comment sont testées les voitures. Le cycle WLTP, c’est un peu comme un examen passé dans des conditions idéales. Votre future voiture est testée en laboratoire, sur des rouleaux, à une température douce de 23°C. Elle roule pendant 30 minutes et 23,5 kilomètres à une vitesse moyenne de… 47 km/h. Oui, vous avez bien lu.
Certes, le test prévoit une petite pointe à 130 km/h, mais elle ne dure que quelques secondes. C’est très loin de la réalité d’un trajet Paris-Lyon au régulateur de vitesse en janvier. En réalité, ce test favorise énormément la voiture électrique en conditions urbaines, qui est une reine de l’efficacité à basse vitesse et en ville, là où elle récupère de l’énergie à chaque freinage. Mais dès que vous sortez de la ville pour prendre l’autoroute, la physique reprend ses droits, et elle est impitoyable.
C’est là qu’intervient ce qu’on pourrait appeler le « mur d’air ». Plus vous roulez vite, plus l’air résiste. Et ce n’est pas vraiment linéaire ! Quand vous passez de 110 à 130 km/h, vous ne gagnez que 20 km/h, mais la consommation d’énergie, elle, bondit de près de 40 %. C’est une loi physique, et on ne peut rien y faire, car même le travail sur l’aérodynamique a ses limites. Ajoutez à cela le chauffage, qui, contrairement à une idée reçue, pèse davantage sur la consommation en hiver que la climatisation en été.
Alors, d’accord, vous allez me dire « Mais mon vieux diesel ne consommait pas tellement plus à 130 qu’à 110 ! ». C’est vrai, mais ce n’est pas flatteur pour le moteur thermique, qui a un très mauvais rendement. Et c’est encore plus vrai en ville, où il gaspille beaucoup d’énergie en chaleur. En revanche, sur autoroute, il chauffe bien et atteint son meilleur rendement. Cette amélioration du moteur compense la résistance de l’air. À l’inverse, le moteur électrique est parfait tout de suite. Il a un rendement de 90 % dès le démarrage. Quand il arrive sur l’autoroute, il ne peut pas « faire mieux ». Il subit donc de plein fouet la résistance de l’air sans rien pour compenser. Résultat, la consommation augmente, ainsi que la différence avec celle en ville, et l’autonomie chute. Ainsi, une voiture électrique peut passer d’une consommation de moins de 15 kWh/100 km en ville en été à plus de 25 kWh/100 km sur autoroute à 130 km/h en hiver. On peut être sur un ordre de grandeur qui est quasiment du simple au double. C’est là qu’il convient de rappeler que le WLTP peut être tout à fait réaliste si vous faites un trajet exclusivement sur route du réseau secondaire par une température extérieure d’au moins 15 à 20 degrés. Dans ces conditions, j’ai déjà fait l’expérience à plusieurs reprises, et notamment parcouru d’une traite 585 kilomètres avec une seule charge, au volant d’une voiture dont l’autonomie WLTP est de 570 kilomètres, sans trainer en route, mais seulement contraint par les limitations de vitesses. Et il faisait 25 degrés.
D’ailleurs, si l’on regarde ce qui se fait ailleurs, c’est ici que la comparaison avec nos voisins américains devient gênante. Aux États-Unis, la norme d’homologation (l’EPA) est beaucoup plus sévère. Elle simule une conduite plus nerveuse, avec de la voie rapide, la clim ou le chauffage allumé. Mais regardons plutôt les chiffres, avec un seul exemple : une Tesla Model 3 Grande Autonomie est vendue en Europe avec 750 km d’autonomie WLTP. La même voiture, sortie de la même usine, est vendue aux Américains avec 584 km d’autonomie. Où sont passés les 166 kilomètres ? Ils n’ont pas disparu. C’est juste que la norme américaine est plus proche de la réalité. Elle vous donne un chiffre que vous pourrez réellement atteindre sur route. En Europe, on vous donne un chiffre théorique, réalisable uniquement si vous faites de la ville par une belle journée de printemps.
C’est cette différence qui crée une frustration inutile. Si on promettait 400 km aux gens et qu’ils en faisaient 400, ils seraient ravis. Si on leur promet 550 et qu’ils en font 400, ils se sentent volés. C’est purement psychologique, mais c’est dévastateur pour l’image de la voiture électrique. Bon, pour vous rassurer et être tout à fait complet, sachez que le cycle chinois CLTC est encore pire que le WLTP, puisque les consommations indiquées là-bas sont encore embellies d’au moins 20%. Conséquence, entre la norme américaine et la norme chinoise, la différence est presque du simple au double. Comment voulez-vous vous y retrouver, et garder confiance dans la capacité de votre électrique à vous emmener loin sans souci de recharge ?
Comment arrêter de se mentir et rassurer tout le monde
Alors, comment on sort de ce marché de dupes ? La solution peut être technologique, mais aussi politique et marketing. En substance, il faudrait déjà juste arrêter de prendre les acheteurs pour des enfants incapables de comprendre la nuance.
Car l’erreur fondamentale est peut-être de vouloir résumer l’autonomie d’une voiture à un seul chiffre. C’est impossible. C’est comme demander : « Combien de temps je peux tenir sans manger ? ». Ça dépend si vous dormez dans votre canapé ou si vous courez un marathon. Pour une voiture électrique, c’est pareil, cela va dépendre si vous faites des courses en ville ou si vous traversez la France par 0°C.
La première solution serait toute bête, comme par exemple changer les étiquettes. Au lieu d’un gros chiffre unique, les constructeurs devraient être obligés d’afficher un petit tableau simple.
- Une colonne « Ville / Mixte » (le chiffre flatteur).
- Une colonne « Autoroute 130 km/h » (la vraie vie des vacances).
- Une ligne « Été » et une ligne « Hiver ».
Si sur la pub de la voiture, vous voyez écrit : « Autonomie : 450 km en ville, 280 km sur autoroute », vous n’avez plus de mauvaise surprise. Vous achetez en connaissance de cause. Des sites indépendants le font déjà, pourquoi pas les constructeurs ?
Alors bien sûr, l’homo numericus automobilus a besoin de choses simples, uniques, et faciles à mémoriser, et ce qui est proposé ici ne va pas forcément dans le sens d’une visualisation et d’une mémorisation rapides. Mais après tout, peut-être que l’humain est capable de s’adapter à une certaine « complexité » quand c’est dans son intérêt, et qu’une bonne communication ne consiste pas toujours à prendre les gens pour des benêts en leur donnant un seul chiffre grossier et inexact à digérer ?
Ensuite, il y a une mine d’or que les marques n’utilisent pas assez, celle de la data. Aujourd’hui, toutes les voitures modernes sont connectées. Les constructeurs savent exactement combien consomment leurs voitures, puisqu’ils reçoivent les données. Imaginez un instant la puissance du message si une marque osait dire : « Voici l’autonomie WLTP légale de 500 km. Mais voici la moyenne réelle constatée sur les 50 000 clients qui conduisent ce modèle : 390 km. » C’est de la preuve sociale. C’est irréfutable, et cela couperait court à tous les débats sur les « bobos écolos » ou les complots industriels, car ce sont des vrais chiffres, issus de vrais gens comme vous et moi. D’ailleurs, peut-être que les flottes d’entreprises pourraient avoir un rôle à jouer en publiant des rapports (évidemment anonymisés) sur la consommation réelle par modèle, remontée des données télématiques.
Enfin, il y a des initiatives comme le Green NCAP. Vous connaissez sûrement l’Euro NCAP, qui donne des étoiles pour la sécurité (les crash-tests). Le Green NCAP fait pareil pour la consommation et la pollution. Si une partie du test est effectuée sur rouleaux comme pour le WLTP, une autre confronte les voitures aux conditions réelles avec notamment un roulage par 14 degrés de température (la moyenne européenne), les lancent sur l’autoroute, et notent le résultat. Si cette note devenait aussi visible que le prix sur le pare-brise en concession, croyez-moi, les ingénieurs se battraient pour améliorer l’autonomie réelle (aérodynamisme, gestion du chauffage) plutôt que d’optimiser la voiture juste pour réussir le test en laboratoire.
Pour finir, la voiture elle-même doit arrêter de nous bluffer. On a tous connu ce qu’on appelle le « devinomètre », cette jauge qui vous annonce 400 km au démarrage et qui tombe à 200 km une heure plus tard. C’est anxiogène au possible. Heureusement, les bons planificateurs d’itinéraire (comme chez Tesla ou via Google Automotive dans les Renault) calculent désormais l’autonomie en prenant en compte le vent, le froid et le dénivelé. La voiture vous dit : « Vous arriverez avec 12 % de batterie ». Et vous arrivez avec 12 %. C’est tout ce qu’on demande, en fait, de la fiabilité.
Les conducteurs sont probablement prêts à entendre que l’autoroute consomme de l’énergie, et à comprendre que l’hiver réduit l’autonomie. Ce qu’ils comprennent moins, c’est d’avoir l’impression que l’on maquille la réalité. Dans ce contexte, une norme plus réaliste ou un affichage plus transparent serait certainement la seule façon de construire une confiance durable.
Et donc de contribuer à une adoption plus rapide de la voiture électrique. Car plus personne ne croit au WLTP, et les dégâts de cette méfiance se comptent certainement en centaines de millions d’euros, et… en empreinte carbone.
sur l'actualité électrique
Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !
Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres
S'inscrire gratuitement