La suite de votre contenu après cette annonce
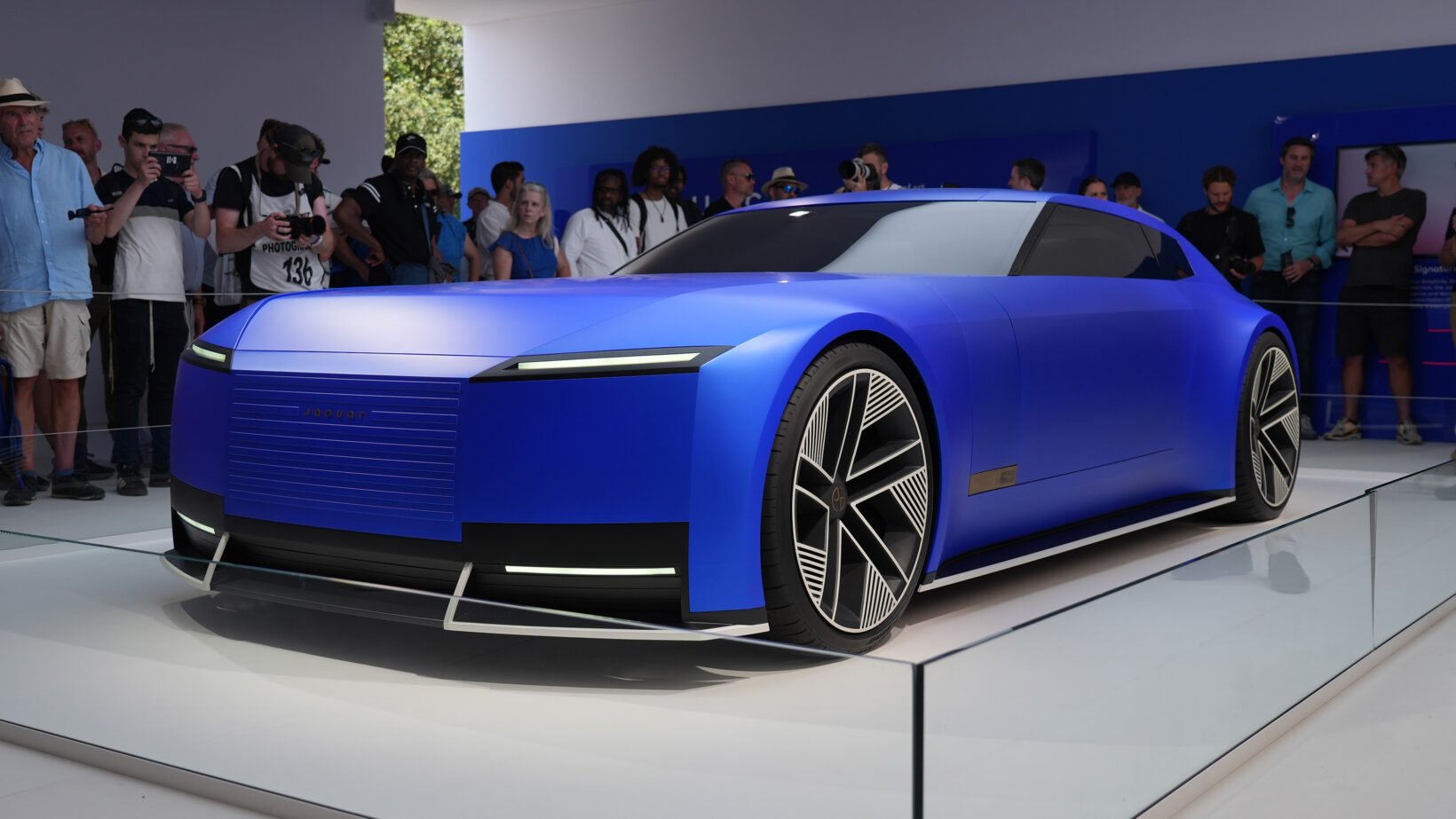
Les ventes de voitures électriques progressent dans de nombreux pays, mais leur adoption reste inégale. Est-ce aussi une affaire de cultures, de classes sociales et de générations ?
En quelques années, la voiture électrique est passée du statut de curiosité technologique à celui de produit de masse. Les ventes mondiales s’accélèrent, les constructeurs multiplient les modèles, les États subventionnent les achats et installent des bornes de recharge. Sur le papier, tout semble réuni pour une adoption universelle.
Voilà pour la face joyeuse de l’histoire.
La réalité est un peu plus nuancée, et il se peut que, si un certain Président mangeur de pommes et amateur de Corona (la bière, pas la voiture) était encore de ce monde, il parlerait de fracture sociale. Car, l’on finit par s’apercevoir que l’électrique n’est pas un objet neutre, et qu’elle est devenue un sujet politique, en tout cas clivant, et finalement assez révélateur des antagonismes de nos sociétés. Il y a des freins culturels, symboliques et psychologiques qui varient selon les pays, les classes sociales et les générations. Ce qui démontre une fois de plus que la voiture, après tout, n’est jamais seulement un moyen de transport, mais qu’elle incarne aussi des représentations, des modes de vie et des aspirations variées.
À lire aussi La voiture électrique pourrait-elle finalement rester un marché de niche à l’échelle mondiale ?
La voiture électrique pourrait-elle finalement rester un marché de niche à l’échelle mondiale ?L’écart entre la Norvège et l’Espagne n’est pas seulement géographique
On sait que, généralement, la diffusion d’une innovation ne suit jamais une trajectoire linéaire. Il en va de même pour l’électrification de l’automobile, présentée comme inévitable, mais qui se confronte à des réalités locales bien différentes selon les pays. En Norvège, par exemple, plus de 90 % des voitures neuves vendues aujourd’hui sont électriques, un record du monde fortement aidé par l’état, qui a mis en place des incitations fiscales très puissantes, mais aussi par une culture favorable à l’innovation verte et le déploiement un réseau de recharge dense, et surtout très bien réparti. À l’inverse, en Italie ou en Espagne, l’électrique reste encore relativement marginale, malgré une forte progression des ventes en 2025. Des pays ou le prix d’achat est perçu comme trop élevé, les infrastructures jugées insuffisantes et où la symbolique de la voiture sportive thermique reste ancrée, notamment en Italie.
Cela alors qu’en Chine, premier marché mondial pour l’électrique, la dynamique est bien différente. L’électrique est devenue une sorte de fierté nationale qui symbolise la toute puissance industrielle de la nation. Les consommateurs l’associent à l’avance technologique de leurs constructeurs, ainsi qu’à une forme de mobilité moderne. Aux États-Unis, c’est le contraste qui est étonnant, avec d’un côté Tesla qui a quasiment inventé le concept, et, au passage, conquis la Silicon Valley, et de l’autre le pick-up thermique qui reste indétrônable dans les états ruraux, où l’électrique est perçue comme une menace pour un mode de vie basé sur l’abondance énergétique.
La voiture électrique est aussi un révélateur de fractures culturelles
Alors certes, et ce n’est pas nouveau, la voiture a toujours été un objet symbolique. Elle ne sert pas seulement à se déplacer, mais elle dit aussi quelque chose de l’identité sociale. Depuis disons les années 1980, posséder une berline allemande est synonyme de réussite. Dans les années 2000, le SUV est devenu à son tour un marqueur de statut social, même si cette distinction s’est très largement généralisée et donc banalisée. L’électrique, quant à elle, véhicule d’autres images, comme l’innovation, une certaine conscience écologique, et la modernité.
Mais ces représentations ne séduisent pas tout le monde. Loin de là.
Car il faut bien admettre que pour une partie de la population, passer à l’électrique revient à renoncer à une certaine idée de la liberté automobile. L’autonomie « illimitée » grâce aux stations-service partout et la possibilité d’improviser un trajet sans calculer les arrêts recharge restent perçus comme des avantages inégalables, alors qu’a contrario, l’électrique est parfois associée à une contrainte, à une limitation.
Il y a aussi la peur du déclassement. Une voiture électrique reste plus chère qu’un modèle thermique équivalent, même avec les aides. Conséquence, pour les catégories les moins aisées, l’impression d’une mobilité réservée aux élites technophiles est bien réelle. Dans certains milieux, l’électrique est même perçue comme un diktat venu d’en haut, une injonction politique déconnectée des réalités économiques.
Enfin, le symbole de la puissance mécanique reste vivace. Pour certains, la voiture est encore associée à la performance brute, au moteur plein de chevaux rugissants, et même encore à la vitesse. Ironiquement, même si l’électrique a désormais largement prouvé qu’elle surclassait les thermiques en matière de performances, son silence et la linéarité de ses accélérations sont vécus comme une perte de caractère, à tel point que, sans vouloir jouer aux sociologues de comptoir, on pourrait presque faire un parallèle avec la notion d’atteinte à la virilité. Bref le VE est réellement perçu par certains comme l’incarnation ultime du truc bobo-écolo, selon leurs propres termes.
Un conflit de générations ?
Autre facteur clé, dont on parle peut-être un peu moins, celui de l’âge, ou générationnel. Ainsi, les jeunes adultes urbains se montrent généralement plus ouverts à l’électrique, et c’est désormais validé par des études sur le sujet : l’acheteur type de VE est en moyenne sept ans plus jeune que l’acheteur de thermique. Ces derniers y voient en premier lieu un prolongement logique de leurs habitudes numériques, à savoir une voiture connectée, pilotable via smartphone, et également alignée avec leurs préoccupations écologiques. Pour eux, la voiture n’est pas forcément un symbole de liberté individuelle absolue, mais un outil de mobilité parmi d’autres. À l’inverse, les générations plus âgées, socialisées avec le thermique, peinent à franchir le pas. L’idée de planifier une recharge leur paraît contre-intuitive. Le bruit d’un moteur leur semble rassurant, presque nécessaire. Dans certains cas, on observe même un rejet actif, en ce sens que l’électrique est perçue comme une rupture violente avec des décennies de culture automobile.
De là à affirmer que les boomers constituent l’essentiel de l’armée anti-VE, nous ne prendrons pas ce risque, car nous connaissons aussi de nombreux trentenaires qui sont totalement réfractaires à l’électrique, et souvent de façon beaucoup plus véhémente. A contrario, on croise aussi beaucoup de quinquas près à partager leur enthousiasme et leur expérience sur les stations de recharge.
Alors, la transition vers l’électrique serait-elle un miroir grossissant de l’évolution de nos sociétés et de leurs clivages ? Quelques indices pourraient le laisser penser. En Europe du Nord, elle est synonyme de progrès collectif. En France, elle est encore marquée par le débat politique et les oppositions sociales et générationnelles. Aux États-Unis, elle divise entre urbains progressistes et ruraux conservateurs. En Chine, elle illustre une conquête nationale et une revanche industrielle.
Elle pose en tout cas la question de notre rapport à la technologie, à l’environnement et à la consommation, en incarnant autant un choc culturel qu’une transition écologique.
Cela étant, il me semble me souvenir que nous avions connu le même genre de querelle entre les anciens et les modernes lors de l’émergence d’internet et des téléphones mobiles. Il y a aujourd’hui 7,43 milliards de smartphones dans le monde, détenus par 5,28 milliards d’humains, soit 64% de la population mondiale.
sur l'actualité électrique
Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !
Découvrez nos thématiques voiture électrique, voiture hybride, équipements & services et bien d’autres
S'inscrire gratuitement







